Yann-Fanch Kemener
DIALOGUES
Nouvelle Création : 30-31 Mars 2006 - QUIMPER
Voix : Yann-Fañch Kemener Cello : Aldo Ripoche Piano : Florence Pavie|
La
matière populaire de Bretagne et les chants en particulier suscitèrent
un grand intérêt pour les lettrés du 19ème
siècle. C’est à cette époque
que l’on voit naître les premières publications. Une
des œuvres majeures, le « Barzaz-Breiz », va avoir une
importance considérable pour la recherche dans ce domaine. Traduit en
plusieurs langues, dès sa première édition en 1839, il va engendrer
d’autres collectes. Celles-ci vont se poursuivre jusqu’à nos jours,
apportant ainsi critiques, nouveaux éclairages et plus grandes
connaissances de ces chants et de cette musique. C’est
également au cours de ce siècle, que C’est
dans cet esprit que Charles Koechlin manifeste son intérêt pour
les musiques populaires, dont la musique bretonne. Entre 1931 et 1932 il
harmonise 20 pièces pour piano et violoncelle, puisées dans le Barzaz-Breiz.
Son
écriture laisse transparaître un goût pour l’harmonisation, mais
surtout un profond respect pour la ligne mélodique. Ce qui fera dire à
Manuel de Falla : « Quant
aux chansons populaires bretonnes, elles ont été pour moi une pure
jouissance. Et avec quelle belle parure vous les avez rehaussées ! ». L’écriture,
qu’elle soit poétique ou musicale, ne nous montre qu’un des aspect
de cette culture. Peu soucieux du regard qu’on lui porte, le peuple
continue de vivre sa réalité de paysan, d’ouvrier… Rythmant son
quotidien, la chanson, la danse ou les histoires, le transporte vers un
imaginaire. Le
renouveau des festoù-noz dans l’immédiate après guerre et les
collectes enregistrées de la fin des années 50 vont nous apporter un
éclairage différent et un autre regard sur ces « passeurs de mémoire
». Timbre, interprétation, style… sont au cœur de la recherche. Fort
de ces réflexions et de notre démarche, j’ai imaginé un dialogue
s’instaurant entre ces 3 réalités : le lettré, le compositeur et le
chanteur populaire. 3 réalités, 3 instruments, 3 temps. Faire
dialoguer, l’oral et l’écrit, la liberté du populaire avec la
rigueur d’une composition ou d’une re-transcription, afin d’en
faire une œuvre actuelle et respectueuse du regard de chacun. Théodore
Hersart de Étudiant
au collège jésuite de Vannes et élève à l'École des Chartes de
Paris, il y passe ses vacances accumulant ses transcriptions de chants
en breton et de leur musique sur des carnets de collecte. Beaucoup des
personnes qui chantent pour lui sont des familiers de sa famille propriétaire
de fermes : paysans, ouvriers agricoles, serviteurs et servantes,
charbonniers, etc. En
1839, il publie le Barzaz Breiz, chants populaires de Cet ouvrage a beaucoup inspiré des compositeurs et des peintres et incité à s’intéresser de plus près à la tradition orale. Charles Koechlin, 1867-1950. "Le
trait essentiel qui domine ma vie, c'est la passion de la liberté."
Les
Chansons bretonnes de Charles
Koechlin ou l’actualisation d’un répertoire populaire ancien. Lorsque
Manuel de Falla fait part à Charles Kœchlin de son
enthousiasme pour ses Chansons bretonnes (1931-1932), opus
115 et opus 115bis,
transparaît également la reconnaissance d’avoir su mettre en valeur
le répertoire populaire dont elles sont issues : « Quant aux Chansons
[bretonnes], elles ont été
pour moi une pure jouissance. Et avec quelle belle parure vous les avez
rehaussées ! ». Bien au-delà d’une réalisation de circonstance,
Koechlin « souhaitait voir nos meilleurs musiciens sauver ces trésors
en voie de se perdre, en facilitant leur diffusion par le moyen
d’harmonisations, d’orchestrations et d’enregistrements […] ; il
prêcha d’ailleurs d’exemple en transcrivant pour violoncelle et
orchestre toute une série de Chansons
bretonnes ». Ces pièces, ayant pour vocation d’être « sans
difficulté à nouveau comprises du peuple d’aujourd’hui »,
illustrent les idéaux socio-politiques du compositeur, ce dernier les
citant en exemple dans deux articles parus dans L’art
musical populaire, « La vraie et la fausse musique populaire » et
« La musique et le peuple». Élaboration
des Chansons bretonnes Sur
son dernier brouillon avant le net Koechlin précise, dans le titre,
qu’il s’agit de Vingt chansons bretonnes extraites de Barzas Breiz. Le recueil de Chants
populaires de Quant
au compositeur, en actualisant certaines mélodies d’un temps révolu,
il s’instaure d’emblée comme un médiateur entre différentes
strates temporelles (celle, difficilement appréciable, de la création
de la mélodie, celle de la fixation par la collecte au XIXe
siècle, la dernière enfin étant
sa présentation au XXe
siècle). Les
Vingt chansons bretonnes, opus 115,
pour piano et violoncelle furent composées entre mars 1931 et 1932, six
d’entre elles furent créées en 1932 et trois autres en 1934, un
manuscrit conservé à Caractéristiques
stylistiques Les
Chansons bretonnes se présentent
sous forme d’un duo, dans lequel le violoncelle énonce la mélodie
dans la majeure partie des cas et le piano sa « parure », l’exposé
de la mélodie de Notre-Dame du
Folgoat au piano constituant une exception. Ce dispositif laisse
transparaître un goût pour l’harmonisation mais surtout le plus
profond respect de la ligne mélodique. Pour Charles Koechlin il
s’agit autant d’une déférence envers un répertoire qu’un procédé
habituel de composition : « sa façon même de travailler lui suggérait
une conception plus mélodique, parfois même tout à fait monodique
[…] nombre de ses compositions ne comportent qu’une
seule partie […] Quant aux œuvres dont, comme Berlioz, il écrit
d’abord le chant, il semble
bien que la vie de l’inspiration gagne à cela ». Sur
un plan rythmique Koechlin est à l’écoute des appuis, accents et durées
propres à chaque mélodie, sensibilité en prolongement de celle de Bourgault-Ducoudray
: « la plus grande originalité de la musique bretonne n’est pas tant
dans la mesure elle-même que dans le nombre de mesures dont se
composent les phrases musicales et dans la construction des périodes mélodiques
». En conséquence le compositeur adopte majoritairement la mesure de
transcription proposée par |
|
Meilleur interprète de la
gwerz, “voix d’or” de la musique bretonne, l’une des plus belles
voix de France : Yann-Fañch Kemener, fils d’ouvrier agricole venu au
chant breton par les berceuses maternelles, fait depuis quelques années
une quasi unanimité dans le monde de la musique et du chant . Avec quelques rares passionnés ou érudits,Yann-Fañch Kemener, dès les années soixante-dix, collecte chants et contes auprès des anciens, véritables passeurs d’une culture alors menacée de disparition, d’oubli. Parallèlement initié,
oralement et a capella, aux techniques vocales des chanteurs de festnoz,
Yann-Fañch parcourt villes et campagnes de Bretagne, à la faveur de la
renaissance des musiques " trads " et folk. Il réalise dès lors ses
premiers enregistrements discographiques : des comptines pour enfants,
du kan ha diskan (chants à deux voix), des gwerz (récits épiques),
des soniou (chants de circonstances) . Une vingtaine de titres depuis
1975. Déjà meneur de gwerzioù, le chanteur forme, à l’âge de la maturité, un duo avec le pianiste forgé au classique et au jazz Didier Squiban. Les deux artistes enchaînent les concerts et les succès avec notamment Enez Eusa (Diapason d’Or – 1996) et Ile-Exil (ffff Télérama). Toujours pour chanter le
terroir, les îles et les légendes bretonnes, il participe au disque
" L’Héritage des Celtes " (Dan Ar Bras – Disque d’Or
– Grand prix de l’Eurovision). En 2000, Yann-Fañch Kemener
engage une collaboration fructueuse avec le violoncelliste classique de
l’Ensemble Stradivaria Aldo Ripoche. Elle a donné naissance à un
premier disque "L’Heure Bleue -An eur glaz" qui associe,
pour la première fois, à une voix bretonne un instrument du répertoire
classique. CREATIONS |
|
Médaille d'or du
conservatoire de région de Caen où il travaille le violoncelle avec
son père Jacques RIPOCHE, il entre à 14 ans au CNSM de Paris dans les
classes de Bernard MICHELIN et Jacques PARENIN. Après avoir obtenu ses prix
de violoncelle et de musique de chambre, il se perfectionne auprès de
Roland Pidoux, Mark Drobinsky et Christophe Coin. Lauréat du concours des
jeunes talents de l'Ouest, finaliste du concours des jeunes solistes de
TF1, il s'est produit dans les principaux pays d'Europe. Passionné de musique française,
il a notamment donné en 1992 la première audition du concerto "Épiphanie"
de CAPLET à Moscou. Curieux de toutes les expériences
artistiques, ce violoncelliste a collaboré à des productions cinématographiques,
chorégraphiques ou théâtrales qui l'ont conduit à Avignon à
plusieurs reprises avec le Centre Chorégraphique de Basse-Normandie et
le Théâtre d'Ostrelande de Caen. Professeur au Conservatoire de
Saint Malo, Aldo Ripoche est égaiement membre de l'ensemble baroque
STRADIVARIA (Folles Journées de Nantes, Festival du Périgord Noir..
.). En 2000, il a enregistré
"L'Heure Bleue" avec le chanteur breton Yann-Fanch Kemener aux
côtés duquel il est désormais présent sur scène, notamment dans
leur création avec Alain Le Goff "Le Grain de |
|
Cursus d’études et de formation
2004: Stage et concert (Noyers sur Serein) avec Anne Queffelec 2002-2003 : Stage de piano école normale ( Paris) avec Anne QUEFELLEC. 1990-1992 : Classe de pédagogie du CNSMD de Paris (Classe de Marie-Françoise BUCQUET) 1992 : Obtention du Certificat d’Aptitude de professeur de piano 1992 : 1er Prix d’accompagnement au piano du CNR de Rennes (classe de 1980 : 1er Prix de musique de chambre du CNSMD de Paris (Classe de Geneviève JOY) 1979 : 2ème Prix de piano du CNSMD de Paris (classes de Reine GIANOLI et Jacques ROUVIER) 1974-1976 : Certificats de solfège, déchiffrage et analyse du CNSMD de Paris
Expérience professionnelle
Depuis 1980 :
Professeur de piano à l’ENMD Laval.
Coordinatrice du département Claviers. Titulaire
Concerts
-Spectacles (Liste indicative et non exhaustive)
Soliste
: 1997 :Concerto pour piano et trompette de D. Chostakovitch Orchestre Les Imaginaires Direction : Nicolas BROCHOT
2001 :Carmina Burana de C .ORFF Version 2 pianos et percussions Chorale Résonances (Rennes)
2002 :1er concerto pour piano de Chopin Orchestre Universitaire de Direction : Philippe LEGRAND (Opéra de Rennes)
2004 : Concerto pour
piano de Schumann dans le cadre des Folles Journées de Nantes Direction : Rémi FERRAND Récitals piano :
Spectacles -Autres expériences artistiques
2003 : Nordosten de M. KAGEL avec l’Ensemble Instrumental de (Skêne Produktion)
2003 : Séjour à Bamako - Improvisations au clavier avec des musiciens maliens (calebasse, tamani, chant, basse)
2003 : Spectacle avec improvisations au piano sur des poèmes de F.
PESSOA |
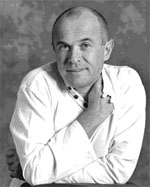

 Florence PAVIE
-Piano
Florence PAVIE
-Piano